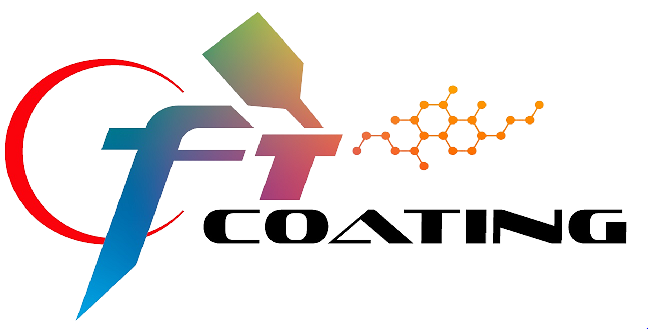- 03 28 42 95 28
Traitement de surface pour le nucléaire
Le traitement de surface nucléaire exige une rigueur absolue : chaque composant exposé aux conditions extrêmes du circuit primaire, des zones combustibles ou des structures confinées doivent répondre à des référentiels stricts. Notre entreprise maîtrise l’ensemble des procédés dédiés aux environnements nucléaires, avec une conformité totale aux normes.
Parmi nos spécialités, la phosphatation certifiée RCC-M garantit la performance et la conformité des assemblages mécaniques du nucléaire civil.
Périmètre des composants et environnements servis
Circuit primaire et auxiliaires
Les pièces du circuit primaire fonctionnent dans des conditions particulièrement sévères. Les alliages comme le 304L, 316L, 321 ou les Inconel 600/690/625 subissent l’action de l’eau borée à des températures comprises entre 290 et 330 °C, sous une pression d’environ 155 bar.
Les contraintes techniques principales incluent :
- Corrosion sous contrainte (SCC) susceptible de provoquer des fissures
- Érosion-cavitation sur les surfaces exposées aux écoulements turbulents
- Rugosité contrôlée Ra ≤ 0,4 µm pour limiter les sites de rétention
- Propreté radiologique stricte pour réduire l'activation et la contamination
Chaque traitement appliqué doit tenir compte de ces paramètres pour assurer une durée de vie optimale des équipements.
Zone combustible et internes de cuve
Les alliages de zirconium (Zircaloy, M5) constituent le matériau de référence pour les tubes de gainage du combustible. Ces composants nécessitent des couches minces à faible activation neutronique. L’objectif : limiter l’oxydation à haute température et améliorer la décontaminabilité lors des opérations de maintenance.
Les traitements PVD ou CVD apportent une protection tout en préservant les propriétés neutroniques du substrat. La faible section efficace de ces revêtements garantit que l’absorption de neutrons reste négligeable.
Zones confinées, sols et structures
Les surfaces des zones contrôlées exigent des revêtements polymères à faible porosité. Ces systèmes doivent résister aux agents chimiques utilisés lors des décontaminations, tout en supportant les contraintes mécaniques et radiologiques. La compatibilité avec les détergents et chélatants constitue un critère de sélection majeur.
Les revêtements époxy, polysiloxane ou polyuréthane offrent une barrière imperméable qui facilite le nettoyage et réduit les temps d’intervention en zone contrôlée.
Enjeux du traitement de surface dans l'aéronautique
Électropolissage et passivation inox
L’électropolissage permet d’atteindre une rugosité Ra ≤ 0,2 µm en dissolvant électrochimiquement les micro-aspérités de surface. Cette finition réduit les sites d’initiation de la corrosion sous contrainte et limite la rétention de contaminants radioactifs.
La passivation complète le processus en enrichissant la couche d’oxyde de chrome superficielle, renforçant la résistance chimique de l’acier inoxydable. Les référentiels ASTM A967 et AMS 2700 encadrent ces opérations pour assurer une reproductibilité totale.
- Réduction de la rugosité par un facteur 3
- Diminution de 40% du temps de décontamination
- Amélioration de la résistance à la corrosion localisée
Vous recherchez un partenaire ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Discutons
Téléphone
03 28 42 95 28
commerce@formuletcoating.fr
Nickel chimique autocatalytique (EN-P / EN-B)
Le dépôt de nickel chimique produit une couche uniforme de 10 à 50 µm d’épaisseur, sans recours au courant électrique. Cette technique garantit une répartition homogène, même sur des géométries complexes.
Les alliages riches en phosphore (EN-P) offrent une excellente barrière anticorrosion dans les milieux chimiques agressifs. La variante bore (EN-B) apporte une dureté supérieure pour les applications soumises à l’usure.
Dépôts PVD / CVD (Cr, CrN, ZrN, TiN, SiC)
Les techniques de dépôt physique en phase vapeur (PVD) et chimique en phase vapeur (CVD) génèrent des couches minces de 2 à 30 µm. Ces revêtements présentent une faible activation neutronique, une dureté élevée et améliorent les propriétés tribologiques.
Le nitrure de chrome (CrN) et le nitrure de zirconium (ZrN) sont particulièrement adaptés aux internes de cuve et aux composants de zone combustible. Leur stabilité thermique et leur résistance à l’oxydation en font des candidats de premier choix.
Projection thermique (HVOF / APS)
La projection HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) et APS (Air Plasma Spray) permettent de déposer des épaisseurs de 100 à 300 µm. Les alliages carbure de tungstène-cobalt (WC-Co), carbure de chrome-nickel-chrome (Cr₃C₂-NiCr) ou Inconel résistent à l’érosion-corrosion et aux hautes températures.
Le contrôle de la porosité (< 2 %) garantit l’étanchéité du revêtement. Les essais métallographiques en coupe permettent de valider la cohésion et l’absence de décohésions interfaciales.
Traitements mécaniques
Le grenaillage de précontrainte introduit des contraintes résiduelles de compression en surface. Cette modification de l’état mécanique retarde l’amorçage de fissures de fatigue et de corrosion sous contrainte.
Le contrôle Almen, documenté selon SAE J442 ou J443, mesure l’intensité du traitement. Les paramètres (type de billes, pression, temps, taux de recouvrement) sont qualifiés et enregistrés pour chaque lot traité.
Phosphatation RCC-M : protection et compatibilité mécanique certifiées
La phosphatation constitue un traitement de conversion chimique qualifié selon le code RCC-M, référentiel français de conception et de construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires REP. Ce procédé est conforme aux paragraphes M1400 et MC 1310 selon l’édition applicable.
Principe et formation de la couche
Le bain de phosphatation transforme la surface métallique en une couche cristalline de phosphate de zinc ou de manganèse, d’épaisseur comprise entre 1 et 15 µm. Cette couche assure trois fonctions principales :
- Protection anticorrosion temporaire durant le stockage, le transport et le montage
- Amélioration du frottement et propriétés anti-grippage lors du serrage
- Adhérence optimisée pour les huiles, lubrifiants ou systèmes de peinture
Applications typiques
La phosphatation RCC-M s’applique aux composants d’assemblage :
- Visserie et boulonnerie
- Goujons de fermeture de cuve
- Brides et éléments de liaison
- Interfaces acier/acier ou acier/inox
- Pièces mécaniques à couple de serrage contrôlé
L’objectif de la phosphatation RCC-M est de garantir un coefficient de frottement stable et reproductible, permettant d’atteindre la précharge souhaitée sans dérive ni grippage.
Contrôles qualité
Chaque lot traité fait l’objet de contrôles rigoureux :
- Masse déposée (g/m2) mesurée par gravimétrie ou fluorescence X
- Aspect visuel : uniformité, absence de zones non traitées
- Adhérence : test de pliage, quadrillage ou pelage
- Compatibilité huile/détergents : essais de mouillabilité et de résistance chimique
- Rugosité post-traitement : validation que le procédé n'altère pas les tolérances dimensionnelles
Conformité documentaire
Notre système qualité assure une traçabilité complète :
- Qualification selon RCC-M et RCC-E
- Dossier QCP (Quality Control Plan) et ITP (Inspection and Test Plan) spécifiques
- Suivi des bains : teneur Zn/Mn, pH, contamination fer, additifs
- Habilitation et formation des opérateurs
- Archivage documentaire conforme aux exigences d'audit ASN et clients
Cette maîtrise distingue notre entreprise comme prestataire habilité RCC-M, capable d’intervenir sur des équipements de classes 1 à 3 et sur des composants auxiliaires selon les exigences de sûreté.
Qualification, essais et contrôles en environnement nucléaire
Contrôles dimensionnels et d'état de surface
Chaque traitement de surface modifie légèrement les dimensions et la rugosité. Les mesures de Ra et Rz (rugosité moyenne et maximale) sont réalisées par profilométrie mécanique ou optique. La porosité est évaluée selon ASTM B733 ou B537, méthodes de référence pour les dépôts électrolytiques et autocatalytiques.
Adhérence et intégrité
L’adhérence constitue un critère de performance critique. Les revêtements épais font l’objet de tests pull-off avec une valeur minimale de 20 MPa. Les couches minces sont évaluées par quadrillage (cross-cut) ou nano-indentation pour mesurer la contrainte interfaciale.
Les essais de choc thermique et de cyclage mécanique valident la stabilité de l’interface sous sollicitations réelles.
Endurance en milieu simulé
Les composants traités subissent des essais en autoclave reproduisant les conditions du circuit primaire : eau borée, température 290-330 °C, pression 155 bar. Les cycles de décontamination chimique (acides, chélatants) sont appliqués pour vérifier la tenue chimique.
Pour les zones combustibles, des essais d’irradiation jusqu’à plusieurs MGy (mégarads) valident la stabilité radiochimique des revêtements.
Propreté et décontaminabilité
Les essais d’essuyabilité mesurent la facilité de nettoyage des surfaces traitées. La contamination surfacique résiduelle est quantifiée après application de traceurs radioactifs simulés. La compatibilité avec les détergents nucléaires (pH extrêmes, agents oxydants) garantit l’efficacité des opérations de décontamination.
Qualité, traçabilité et conformité documentaire
Référentiels et certifications
Notre système de management s’appuie sur les référentiels internationaux :
- ISO 19443 : système qualité spécifique au nucléaire civil
- ISO 9001 : management de la qualité
- RCC-M : codes de conception français pour matériels mécaniques et élecrtiques
Études et co-Ingénierie
Nous intervenons en amont de vos projets pour optimiser la sélection des procédés et des matériaux. Notre approche inclut :
- Analyses des modes de défaillance, de leurs effets de leur criticité ciblées
- Modélisation des épaisseurs et des contraintes résiduelles
- Essais sur coupons représentatifs pour valider les hypothèses de conception
- Qualification de nouveaux procédés selon les référentiels clients
Cette collaboration précoce réduit les risques de non-conformité et optimise les coûts de traitement sur la durée de vie des équipements.
Appelez-nous
03 28 42 95 28
Contactez nos équipes
Un projet à mener ? Un renseignement ? Prenez contact avec l’équipe FT Coating et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.
Merci de détailler différents points : matériau et environnement, conditions d’exploitation, exigences normatives, volumes et planning…
Traitements
Secteurs d'activité
Coordonnées
- 71 Rte de Saint-Omer, 59670 Bavinchove
- 03 28 42 95 28
- commerce@formuletcoating.fr
- 7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00 du lundi au vendredi